12/07/2012
Richter ratrak
Les trois images ci-dessus devraient se suffire à elles-mêmes. Les légendes pourraient être, pour la première «Gerhard Richter, Eis, 1981», pour la seconde «image extraite de Gerhard Richter Painting de Corinna Belz, Zero One productions 2011», et pour la dernière «Ostfront: Deutscher Panzer im Schnee (Dezember 1941)».
Le rapport étrange de Richter avec la neige et la glace m'est apparu petit-à-petit en visionnant le film de Corinna Belz. D'abord, c'est le blanc. Au cours des longues séquences où on le voit peindre, arrive le moment où le blanc (de titane, nous précisent les assisants) fait son apparition. On voit Richter en incorporer une noix dans un océan vert dont la vibration n'était sans doute plus suffisante. Les peintres savent que c'est un tournant dans l'élaboration d'une toile, lorsque la lumière qui jusque-là vient de la préparation blanche qui couvre le support entre en conflit avec celle que faît naître la masse pâteuse, couvrante, volumineuse du blanc qu'on incorpore dans l'appareil en suface. Ce moment est vécu intensément par Richter, me semble-t-il, et peut sans doute expliquer son goût pour le gris (dans ses monochromes gris ou ses peintures d'après photos noir/blanc) puisque le jeu avec le blanc s'y déroule en dehors de toute considération chromatique éventuellement perturbante.
Ensuite il y a le blanc encore, cette fois-ci non pas incorporé, mais appliqué au moyen d'un immense racloir en plexiglas posé à plat sur la surface de la toile et qui déforme la structure visible par le jeu des adhérences spécifiques de chaque matière en contact avec la pâte picturale, des légères variations dans l'orientation de l'outil et de sa vitessse de déplacement. Ces racloirs immenses, construits sur mesure pour chaque format de toile, évoquent le ratrak, la dameuse, la resurfaceuse de patinoire. Richter surfe (au pinceau), puis passe la dameuse, skie ou patine (selon qu'il réintervienne au pinceau ou gratte, scarifie les couches au couteau à peindre) puis passe la resurfaceuse, et ce processus peut continuer sur de nombreuses séances, interrompues par de longues poses. Richter, dans le genre peintre, est un resurfaceur.
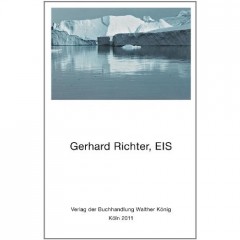 Richter a lui-même clairement évoqué la neige et la glace dans ses peintures. Avec plusieurs séries titrées Eis datant de différentes périodes, avec des toiles figuratives représentant des sommets enneigés, des glaciers ou des icebergs. Il a par ailleurs fait un voyage au Groenland en 1973, collectant de nombreuses photos hypnotiques des paysages glacés et glaciaux des abords de l'océan arctique. Ces photos, qui ont été publiées en 2011 dans un volume intitulé Eis par Walther König à Cologne, ont servi de base pour quelques peintures.
Richter a lui-même clairement évoqué la neige et la glace dans ses peintures. Avec plusieurs séries titrées Eis datant de différentes périodes, avec des toiles figuratives représentant des sommets enneigés, des glaciers ou des icebergs. Il a par ailleurs fait un voyage au Groenland en 1973, collectant de nombreuses photos hypnotiques des paysages glacés et glaciaux des abords de l'océan arctique. Ces photos, qui ont été publiées en 2011 dans un volume intitulé Eis par Walther König à Cologne, ont servi de base pour quelques peintures.
Mais c'est au cours du film, dans une séquence d'interview, qu'il donne, dans l'éclat d'un witz qui semble lui échapper complètement, une clef pour comprendre ce que le resurfaçage peut signifier pour lui. Corinna Belz l'interroge sur son passage à l'ouest en 1961. On calcule rapidement qu'il avait alors 29 ans. Elle lui demande si et quand il avait pu retourner à l'Est, voir la famille, ses parents, et la réponse tombe: impossible, il n'a finalement pu y retourner que peu avant la chute du mur. Corinna Belz insiste: a-t-il revu ses parents? — Non, bien sûr, ils étaient tous morts. L'ambiance devient assez pesante. Le regard de Richter se promène dans toutes les directions. Savait-il en partant qu'il ne les reverrait plus? — Non, on ne se rend pas compte. Ils étaient encore jeunes quand je suis parti. On ne peut pas imaginer… On se dit que tout restera tel quel pour toujours. Les endroits et les gens qu'on laisse en partant sont figés dans la mémoire… Long silence. Puis les yeux s'allument et Richter rit parce que l'image qui lui apparaît soudain, il la connait déjà et ça le fait rire à chaque fois. Est-ce De Funès en Hibernatus qu'il voit surgir devant lui? En tout cas il ajoute dans un hoquet: Comme ces gens qu'on retrouve dans les glaciers!
14:13 Publié dans regarder de la peinture | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook
Facebook
22/08/2011
Pop compilation I (Fabiola Cloaca)
Francis Alÿs présente sa collection de portraits de Sainte Fabiola dans la cossue «Haus zum Kirschgarten» du Musée Historique de Bâle, dans une exposition proposée hors ses murs par le Schaulager.
Passé l'entrée, on est conduit dans le jardin intérieur, où un petit pavillon présente une première série de 67 Fabiolas. Huiles sur toiles, formats standardisés: S et XS (20P et 15P) et programme iconographique ultra-réduit: sur un fond verdâtre, un voile rouge (plus romain que monacal) forme un pli vulvaire dans l'axe de symétrie vertical du tableau; en dessous, un profil féminin découpé à la scie sauteuse, sourcil levé, regard lointain; frange, joues rouges, lèvres closes: supérieure en général fine et inférieure pulpeuse; menton galbé comme une fesse.
300 peintures sont ensuite visibles, réparties dans tous les coins du musées, vaguement classés par techniques: broderies, émaux, miniatures, grands formats. On comprend que la récolte de Francis Alÿs est de longue haleine, qu'il a probablement écumé marchés aux puces, vide-greniers et brocantes pendant des années.
Fabiola en feutre et boderie (merci à Luc et Sandro)
Fabiola (dont je n'ai jamais entendu parler) est visiblement une sainte populaire, star sexy et spirituelle, et son image a été produite à la chaîne au 20e siècle (quelques dates relevées: 1949, 1990, 1975, 1948) par une foultitude de peintres plus ou moins habiles (Aneker, V. Ch., Desmet A., Lulu, Francis Huys) et d'après un modèle unique. Je découvre le nom de l'auteur du prototype grâce à J. Verulpens (?) qui a l'élégance de citer sa source et qui note «d'après Henner».
La fortune du «modèle» créé par Henner (dont j'apprends par le catalogue qu'il a été peint en 1885 et qu'il a disparu en 1912) et sa répétition (toujours manuelle, pas de procédés de reproduction technique ici) provoque une sorte d'hallucination. Les raisons de son succès ne sont pas mystérieuses: Henner a parfaitement réussi son coup. Sa Fabiola irradie de sensualité puritaine, agrégeant la statuaire d'un Dante «apaisé» à l'imagerie d'Epinal d'un Petit Chaperon Rouge pubère (qui fait d'ailleurs les beaux jours de la publicité dans nos vallées télévisuelles). Elle possède l'aura standardisée d'une princesse bollywoodienne et l'obscénité de l'Origine du monde de Courbet. La force de frappe visuelle d'une ombre découpée et la tendreté d'un macaron parfumé à l'eau de fleur d'oranger.
Le geste de Francis Alÿs est lui plus étrange. A quoi sa collection sert-elle? Ou pour être plus précis: que signifie l'exposition de sa collection? Elle a toutes les caractéristiques d'un geste artistique: programme, sérialité, compilation, archivage, critique et ludicité. La notion d'auteur et d'œuvre est évacuée: il ne s'agit pas de décider qui a fait la plus belle Fabiola, ni qui a eu le plus d'inventio dans son exécution. Les différences entres les peintures sont des «variables», dues à l'habileté relative de l'auteur, à sa proximité avec l'«original» perdu (a-t-il une bonne reproduction? fait-il une copie de copie?). Il y a autant des croûtes bâclées à la va-vite que de joli morceaux de peinture (rares tout-de-même), mais la question n'est bien sûr pas là. Alors quid?
Ces Fabiolas ont été faites et sont collectées pour leur valeur d'échange et d'usage: elles remplissent les conditions pour servir d'icône populaire et petite bourgeoise autant du point de vue technique (c'est fait à la main, donc unique, mais c'est pas cher car en général très vite fait) que du point de vue iconographique (Fabiola est une sorte de Hausfrau inspirée, une matrone consolatrice et une infirmière: un modèle d'épouse et de «femme d'intérieur»). Son portrait n'est pas un objet de dévotion, ni de méditation, mais un modèle (un patron) auquel sont comparées les filles et femmes de la maisonnée.
Il s'agit ici de commerce et de normes (de politique domestique). Une collection de billets de banque périmés ou provenant d'un pays qui n'existe plus. Avec une couche de sentimentalisme bien régressif. On pense bien sûr aux icônes standardisées que sont les Marylins ou les Dollars Bills de Wahrol, sauf les Fabola sont reproduites non pas par les sérigraphes de la Factory, mais par des centaines de tâcherons éparpillés à travers le monde.
Que signifie l'exposition de cette collection dans un lieu «culturel»? Elle me donne un choix: soit de critiquer la norme (ce qui me met dans une position paternaliste face à la consommation d'une icône populaire dont je déjoue les mécanismes d'oppression avec la satisfaction de l'élite) soit de valoriser les écarts à la norme (ce qui m'amène à regarder ces peintures comme des assiettes «peintes à la main», à repérer les maladresses et les ratés, bref à opérer un «contrôle-qualité», avec comme filtre: «ça passe» ou «comme c'est mignon, il s'est donné de la peine»).
En exposant ces 367 peintures, Alÿs opère une mise-à-nu particulièrement violente (lucide) de 367 gestes picturaux qui ne valent que par leur soumission à une règle (que le spectateur est mis en situation de critiquer) et par l'artisanat qu'ils démontrent (devant lequel le spectateur est mis en situation de s'attendrir). Eh oui, ça n'est que ça, la peinture (car si cette exposition parle d'imagerie populaire, de collection, de compilation, de politique iconographique, elle parle AUSSI de peinture): de faux billets maladroitement imités, de pauvres étrons humblement sculptés par des boyaux soumis au besoin primaire.
22:20 Publié dans art = merde, bavettes, regarder de la peinture | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook















