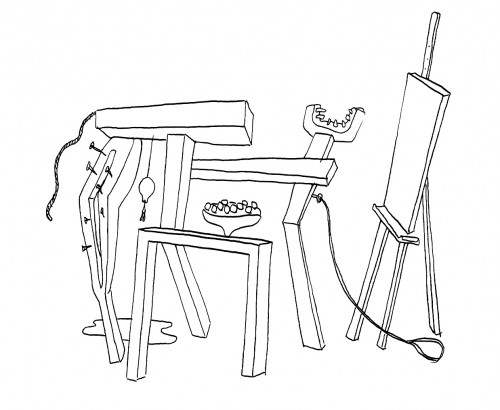08/04/2009
Cosmologie
14:31 Publié dans le modernisme | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
19/03/2009
La vie punit quiconque ne prend pas le globe au sérieux
Stéphane Zaech, «Spanish Point» huile sur toile, 2008
Dans une série de peintures datant de 2008, Zaech peint des sortes de majas, des duchesses d'Albe, dressées dans de somptueux paysages au ciel outremer où parfois passent des nuages en forme de dragons. Certaines d'entre elles ont un ou deux yeux exorbités, certaines en ont même trois!
Lorsqu'on connaît la dette de Zaech au «nominalisme pictural» de Picasso, ce troisième œil fait l'effet d'un coup de tonnerre. Picasso n'a en effet jamais peint de visages à trois yeux. Malgré toutes les «déformations» qu'il a fait subir aux milliers de visages de son pandemonium, il s'en est toujours tenu à un programme simple: «0+0=la tête à Toto». C'est le programme du nominalisme pictural. Dans la phrase «Il passe sa main dans ses cheveux», le mot «main» a toujours cinq doigts, même si trois d'entre eux disparaissent dans la chevelure. Le nominaliste peint cette main-là, la main en tant que mot, avec ses cinq doigts, plutôt que celle qui apparaît dans l'image qu'on pourrait se faire de la scène et qui n'en montre peut-être que trois. On comprend donc que le nominalisme n'exclut pas que «0+0=la tête à Toto de profil», il peut aussi justifier «0+=la tête au cyclope» ou même «0+0+0=la tête à Bouddha», mais dans le cas présent, dans «Circé Plaza», par exemple, il ne s'agit ni d'un cyclope, ni d'un bouddha: trois yeux, du point de vue du nominalisme, c'est donc un œil de trop.
Deux hypothèses: soit Zaech sort du nominalisme et on peut s'attendre à voir bientôt apparaître dans son œuvre les créatures les plus étranges, dotés des attributs les plus extraordinaires en nombre et en incongruité, soit il s'y tient toujours et de ce cas ce troisième œil est nécessaire pour donner un nom à la figure qui se dresse devant nous. 0+0+0 égale quoi, si c'est pas la tête à Bouddha?
Observons ces yeux, et en particulier le surnuméraire, placé entre les deux autres, qui sont dans leur orbite naturelle. Il est exorbité, écarquillé, dépourvu de paupière. Il semble posé à la surface du visage, sans connexion nerveuse, un globe oculaire luisant, humide, apparemment vivant, apparemment même voyant, mais flottant, mis à nu, trop visible. Il est globuleux, et il faut donc le prendre au sérieux. Que fait-il là? D'où vient-il?
1507, un hidalgo nommé Van
Pour tenter de comprendre il faut remonter un peu dans le temps et s'arrêter sur une série de peintures qui a précédé celles-ci, sous le titre générique de «Visions de Van».
Ici, le nom du personnage est donné: Van. Dans un entretien, Zaech précise: «C'est le Van de Nabokov, le Van de Van Gogh.» C'est une particule: van, von, de, da, della, etc. De quelqu'un portant un nom à particule on dit en français : «un de quelque chose», en espagnol, ça se dit exactement «hidalgo». (Hijo de algo, fils de quelque chose). Et c'est bien une sorte d'hidalgo que ce Van. Sapé comme un milord, affublé de boucles d'oreilles, colliers, ceinturons, collerettes, arborant la croix de l'ordre de Santiago (celle que porte Velazquez dans son autoportrait des «Ménines), bagousé comme un mafioso de série Z, capé, chaussé de belles bottes ou de baskets rutilantes. Il ressemble assez aux mousquetaires du dernier Picassso, c'est un peintre, comme eux, avec son pinceau et parfois une palette à la main. Sur ses genoux se love, s'enroule, s'entortille un femme, belle, assez déshabillée, sensuelle. Dernier détail : Van a souvent le visage peint. Peint comme les indiens d'Amérique et Zaech précise : «ce sont des peintures de guerre». Il a souvent aussi une coiffe de plumes d'aigles (ou de carottes).
Cette série s'achève dans une toile monumentale — où l'on retrouve Van et sa compagne, sur la gauche — intitulée «Loyola (Mystère de la peinture ou La découverte de l'Amérique». Découverte et mystère, avançons-nous vraiment? Je décide de rester sur les traces du globuleux et je remonte encore le temps. Nous sommes en 1507. C'est la date qui me semble la plus plausible où situer cette histoire de peinture et d'Amérique. Le Titien a 17 ans, Luther 24 et il est ordonné prêtre à Erfurt, Loyola (Ignace de) a 16 ans, Christophe Colomb vient de mourir et Martin Waldseemüller (pas un de quelque chose, c'est le meunier du lac dans la forêt) lance la première fabrication en série de globes terrestres imprimés, (les précédents étaient toujours peints à la main), les premiers aussi à porter l'inscription «America». C'est le début de la «globalisation terrestre» qui occupera pendant 500 ans cartographes, marins, marchands, politiciens, climatologues, écologues et terroristes et qui, peu à peu, a changé la vision que les hommes ont de leur terre natale. Le globe (en tant qu'objet) annonce «le message topologique des Temps Modernes; les gens sont des créatures vivantes qui existent en marge d'un corps rond irrégulier — un corps qui, en tant que tout, n'est pas un utérus ni un vase, et n'a pas d'abri à offrir où l'on se sent en sécurité. (...) Il restituera toujours l'image d'un corps auquel il manque le bord protecteur, la voûte sphérique externe. Ce qui se trouve à sa surface apparaît déjà comme un extérieur. (...) Quand on observe le globe terrestre, on est invité à se concevoir comme une créature située à la frontière entre la terre et le néant.» (Peter Sloterdijk, «Le palais de cristal», Maren Sell, 2005).
Je ne crois pas que Zaech soit un lecteur de Sloterdijk, (je sais même que non), mais sa méditation picturale sur le l'œil globuleux et, nous y arrivons, sur le toutes sortes d'autres globes, entre en écho avec celle du philosophe sur le globe terrestre.
Des globes, beaucoup de globes
Sphères et globes apparaissent chez Zaech d'abord sous la forme de soucoupes volantes (il y en a une dans «Loyola (Mystère de la peinture ou La découverte de l'Amérique», ainsi qu'un observatoire et une lanterne sphérique). Dans «Coney (Vierge au lapins)», on voit une princesse échappée de l'Escurial habiter une forêt féerique en compagnie d'animaux complices. A ses pieds une sphère en verre intrigue un lapin. Dans « Spanish Point », le globuleux se multiplie: une boule de cristal, encore, les deux yeux ronds d'un crabe qu'on dirait sorti d'un dessin animé Pixar, les globes deux seins prêts à déborder du corsage, et finalement un œil exorbité sur la duègne hallucinée au centre de la composition. Dans «Circé Plaza», cette même duègne se voit affublée de l'œil globuleux surnuméraire qui a déclenché mon interrogation.
Revenons à «Spanish Point». Le globe comme paradigme de la visibilité (puisque c'est l'instrument de la vision globale du monde qu'on peut tenir dans ses mains ou faire rebondir sur ses fesses — un globe terrestre ayant appartenu à Hitler a d'ailleurs été vendu à cinq fois son prix d'estimation à un hôtelier de San Francisco fin 2007) est ici exploré sous tous ses aspects. D'abord, en partant de la gauche, la boule de cristal dans laquelle la gitane lit (voit) ce que l'esprit inquiet qui la consulte y projette. Puis l'œil multi-facette du crabe, qui peut s'enterrer dans le sable et y disparaître entièrement et pourtant surveiller la plage et les proies potentielles qui s'y promènent en faisant émerger ses périscopes oculaires à la surface, puis deux seins parfaitement sphériques que l'on voit à la fois de face et de profil posés sur le balcon du bras et à peine raccordés au torse, c'est peu de dire qu'il sont «offerts» au regard. Et finalement cet œil exorbité, qui semble aspiré ou expulsé hors de sa cavité sans qu'on puisse déterminer si c'est dû à une force interne ou externe. Tous ces globes sont alignés au plus proche de nous sur le bord extrême du plan qui nous sépare de la peinture. Un peu plus, et ils pénètrent dans «notre» espace, ou ils roulent à nos pieds. Cette proximité est paradoxalement accentuée par la perspective d'une profondeur impressionnante — suggérée par une plantation d'arbres qu'on suppose dessinée au cordeau — et surtout par l'effet de précipitation, qui pourrait ici encore être emprunté au dessin animé, que génère la disposition de doubles, de multiples de la figure centrale semés à distance régulière derrière elle et diminuant de taille (ou augmentant suivant le sens de lecture) de façon exponentielle selon les lois de la perspective classique. L'effet sur le spectateur est radical: on dirait qu'elle fond sur nous comme une buse surgie du fond de l'espace, comme une météorite, et on hésite à rester en place devant la peinture, prêt à s'écarter pour éviter la collision.
Paysage vu de profil?
Les peintures de cette série ressemblent à des portraits dans un paysage, ils sont d'ailleurs directement inspirés des portraits de la Duchesse d'Albe de Goya. Pourtant l'expérience du regard y est toute différente. Dans « Circé Plaza», comme dans les autres peintures de la série, il n'y a pas à proprement parler de paysage, ni vraiment de portrait. La scène naturelle dans laquelle est posée la Circé du titre, avec ses arbres, ses montagnes, son ciel, ses nuages, sa végétation, n'offre pas de géographie mentale dans laquelle le spectateur pourrait vagabonder, divaguer. Aucune place pour la méditation mélancolique, la rêverie sur l'Arcadie perdue. Le paysage n'est pas une scène, il est tout entier dispositif, machinerie théâtrale qui n'a qu'une fonction: plaquer des globes le plus près possible de notre regard, nous bombarder de particules, nous exposer à son irradiation. On ne pénètre pas plus dans «Spanish Point», on est attiré par sa force de gravitation et maintenu en orbite. Tournant autour d'elle, le regard braqué dans sa direction, on se trouve à marcher de biais, comme le crabe, et à penser: «C'est dingue, elle me suit du regard». Bien sûr, tous les portraits nous font ce coup-là, de nous suivre du regard. «Circé Plaza»,«Spanish Point», ou leurs cousins, sont-ils pour autant des portraits?
Face à face vu de face
Je me poste face à Circé. Je suis bien en face d'une figure à peu près humaine, mais je ne me sens pas dans la sphère intime d'un espace interfacial. La face qui me fait face ne me semble pas dotée d'une intériorité sur laquelle je puisse projeter (voire construire) la mienne. Cette face est-elle humaine? Des signes m'invitent à le croire: grâce délicate des articulations, familiarité de la posture, sensualité de la texture de la peau... pourtant elle reste impénétrable. Comment regarder au fond des yeux une figure qui porte son œil exorbité comme une verrue sur le visage ? Sans paupière, c'est un œil qui ne se ferme jamais sur son espace intérieur faute d'outillage adéquat, et dont tous les liens avec le corps semblent rompus. Le regard flotte à la surface de la peau: «Eyes without a face got no human grace». Pourtant elle voit, je vois qu'elle voit. Mais, pure vision externe, elle ne m'offre pas son regard. Je suis face à un écran, face à une paysage qui m'aspire et me repousse immédiatement hors de lui, face à une face qui me fascine mais qui ne me regarde pas, qui ne me donne pas l'hospitalité de son regard.
Voilà donc à quoi sert le dispositif globuleux de Zaech: montrer l'espace entre deux faces qui est aussi celui entre la peinture et le spectateur suivant le plan de la croûte peinte et de la mince couche atmosphérique qui la recouvre. Cet espace, infra-mince, n'est «habituellement» visible que sous l'effet de drogues ou de la schizophrénie. Là, j'y suis; je vois le face à face... de face.
L'étonnant, c'est que cet espace a déjà été peint, par Giotto dans une fresque du cycle Scrovegni, «Le baiser de Judas», comme le montre Sloterdijk. «Dans le tableau de Giotto, cette déchirure sphérologique s'ouvre de manière dramatique entre ces deux visages entrés en confrontation, les yeux dans les yeux. Entre les profils des protagonistes, s'ouvre dans l'image une mince cavité qui rappelle la forme d'un calice.» (Peter Sloterdijk, «Sphères I, Bulles, Arthème Fayard, 2002) Bien sûr, le face à face est ici vu de profil, depuis le point de vue du troisième homme, le spectateur, qui a donc devant lui des profils. Mais ce que Sloterdjk n'a pas vu, victime peut-être de la vieille illusion d'optique qui fait voir un vase dans la découpe de deux profils qui se font face, c'est que la «cavité» est plutôt convexe, voire globuleuse! Giotto a en effet réussi à y caser deux autres visages - deux soldats sur les 19 qui entourent le groupe dont quatre seulement ont le visage visible - qui dédoublent ceux de Judas et de Jésus. On distingue un morceau de profil au-dessus de celui de Judas et une portion de visage de face dans le minuscule espace restant. Sont visibles une bouche, deux nez, et... trois yeux!
«Dans le tableau de Giotto, cette déchirure sphérologique s'ouvre de manière dramatique entre ces deux visages entrés en confrontation, les yeux dans les yeux. Entre les profils des protagonistes, s'ouvre dans l'image une mince cavité qui rappelle la forme d'un calice.» (Peter Sloterdijk, «Sphères I, Bulles, Arthème Fayard, 2002) Bien sûr, le face à face est ici vu de profil, depuis le point de vue du troisième homme, le spectateur, qui a donc devant lui des profils. Mais ce que Sloterdjk n'a pas vu, victime peut-être de la vieille illusion d'optique qui fait voir un vase dans la découpe de deux profils qui se font face, c'est que la «cavité» est plutôt convexe, voire globuleuse! Giotto a en effet réussi à y caser deux autres visages - deux soldats sur les 19 qui entourent le groupe dont quatre seulement ont le visage visible - qui dédoublent ceux de Judas et de Jésus. On distingue un morceau de profil au-dessus de celui de Judas et une portion de visage de face dans le minuscule espace restant. Sont visibles une bouche, deux nez, et... trois yeux!
Voilà, la boucle est bouclée, les sphères ont chanté, les globes ont globulé. A qui le tour?
mars 2009
14:36 Publié dans regarder de la peinture | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook